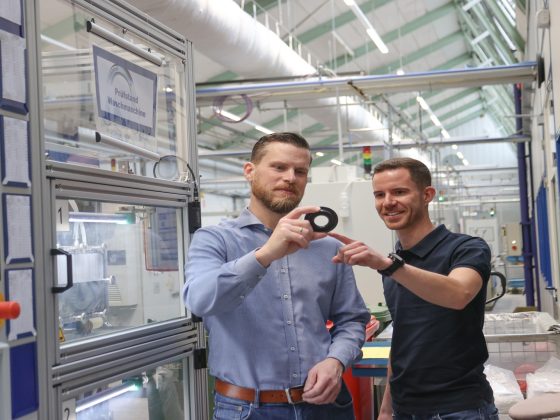Carl Johann Freudenberg – c’est avec lui que commence l’histoire et la réussite du Groupe technologique Freudenberg. Le 9 février 1849, il fonde à Weinheim, avec un partenaire, une petite fabrique de cuir. C’est le début de l’ascension incomparable qui devait mener à une entreprise mondiale, essor parfaitement documenté, entre autres dans des archives modernes. Mais que nous révèlent ces documents de la personnalité de son fondateur, de l’homme Carl Johann ? Comment sa manière de penser et d’agir impose-t-elle aujourd’hui encore son empreinte aux valeurs de l’entreprise Freudenberg ?
Julia Schneider, archiviste de notre entreprise, raconte : « Imaginez un jeune créateur d’entreprise dont le troisième enfant vient de naître et qui, en pleine guerre civile, emprunte une grosse somme à son beau-père pour racheter une petite société industrielle en faillite ! » Cette approche certes un peu simplifiée de la personne de Carl Johann le montre bien : il ne manquait sans doute pas de confiance en lui. Il a eu aussi la chance de pouvoir profiter d’une constellation propice pour passer peu à peu de la position d’apprenti à celle de copropriétaire, et plus tard de seul propriétaire de son entreprise. Mais de quoi cette constellation est-elle faite ? Qu’est-ce qui a poussé ce jeune père de famille de 30 ans, au cœur d’une période pleine d’incertitude, à croire au succès ? « D’une part des traits de caractère favorables, mais aussi les compagnons de route appropriés, tant sur le plan professionnel que privé », explique Julia Schneider.

L’enfant
Carl Johann n’a que 9 ans à la mort de son père, Georg Wilhelm. Celui-ci avait tout d’abord tenu l’auberge « Zum Löwen » à Hachenburg, une petite ville située entre Cologne et Francfort. Les débuts de l’industrialisation ont généré une crise accompagnée d’une grande pauvreté, et les affaires vont mal. Début 1829, l’auberge doit fermer, et l’aubergiste doit changer complètement de métier. Il devient responsable du poste de douane de Weilburg an der Lahn, où il meurt peu après, le 9 mars 1829. Le seul à être auprès de lui : son fils Carl Johann, qu’il a emmené avec lui à son départ de Hachenburg. La famille est en deuil, et se bat pour survivre. La mère de Carl Johann s’installe avec lui et ses cinq frères et sœurs à Neuwied, où de proches parents assurent financièrement leur existence. À 14 ans, Carl Johann doit se suffire à lui-même et commence un apprentissage dans le commerce de cuir de son oncle, à Mannheim, à 200 kilomètres de Neuwied – une distance énorme à l’époque. « La misère dans laquelle se trouvait sa famille a certainement déclenché quelque chose en lui – et certainement aussi la volonté de réussir dans la vie », conclut Julia Schneider. « Nous le voyons dans la période qui suit, où son ambition, son travail assidu et son caractère économe font de lui un self-made man. »
L’ascension
Carl Johann est seul et ne peut compter sur personne. Mais il découvre vite ses points forts. Il est apprenti chez son oncle Johan Baptist Sammet et l’associé de celui-ci, Heinrich Christian Heintze, à Mannheim – comparée à sa commune natale, une ville trépidante. « C’est l’époque à laquelle il se rend compte des effets positifs que ses actions et ses aptitudes peuvent avoir sur sa vie. Il prend confiance en lui, ce qui l’aide à poursuivre son objectif de réussir dans la vie », souligne l’archiviste. Travailleur et ambitieux, le jeune homme ne se contente pas de servir les clients au comptoir du commerce de cuir et de livrer des marchandises, il tient aussi, depuis le magasin, un négoce de cigares à son propre compte. Lui qui n’a fréquenté aucune école secondaire apprend le français et l’anglais, va régulièrement au théâtre national de Mannheim, évolue avec une assurance croissante dans des cercles bien considérés internationaux, et fait preuve de ses talents dans l’entreprise de son oncle. En 1844, il acquiert 20 % des parts de l’entreprise en tant que bailleur de fonds.
L’époux
La même année, il épouse Sophie Martenstein, dont il a fait la connaissance un an plus tôt au printemps dans une « Liedertafel », une société chorale. Sophie Martenstein est issue d’une famille aisée de Worms. Son père fait le commerce d’épices, et est un homme d’affaires respecté. Il consent à cette union, et ne se contente pas de se renseigner sur les sentiments, le caractère ou l’apparence du jeune homme. Il s’agit aussi de sa situation économique, financière et professionnelle. Sophie écrit dans ses mémoires : « Convaincu qu’il aurait ainsi un gendre posé et travailleur, qui avait gagné déjà 5.000 florins [ce qui correspondrait à environ 100.000 euros aujourd’hui], il fut enclin à lui confier sa seule fille. » Au cours des années qui suivent, deux filles voient le jour, Elise et Luise, laquelle meurt cependant très tôt. Lorsque son fil, Friedrich Carl, naît en 1848 à Mannheim, la révolution badoise bat déjà son plein.

Le contemporain
Mais que se passe-t-il devant la porte de Carl Johann à Mannheim ? Les enjeux sont la liberté de la presse, l’instauration de cours d’assises, et d’un État national allemand avec un parlement élu librement. Jusqu’alors, le pays n’est qu’une mosaïque de territoires autonomes, dont le grand-duché de Bade avec la ville de Mannheim. Les révolutionnaires sont divisés en deux camps : le clan libéral constitutionnel et le camp démocratique radical. Mannheim est secoué par des émeutes, la population réclame un changement profond, des assemblées populaires se réunissent dans l’ensemble du Land, avec des milliers de participants. Des batailles ont lieu dans les rues. « Les commerçants et les hommes d’affaires, qui souhaitent bien entendu toujours une situation politique stable, sont inquiets. C’est aussi le cas pour Carl Johann », explique Julia Schneider.
L’entrepreneur
Des tempêtes politiques s’abattent sur le Land et entraînent également la chute de la banque qui finance, par des lettres de change, le commerce de cuir. L’entreprise est confrontée à des difficultés de paiement et doit être dissoute en 1848. « Freudenberg a la chance de pouvoir profiter de cette crise comme d’une opportunité parce qu’il a derrière lui une famille solide qui peut lui donner une aide financière de poussée », poursuit Julia Schneider. Son beau-père, qui l’estime beaucoup, met à disposition de sa fille le capital nécessaire pour qu’elle puisse soutenir le projet de son mari : reprendre une partie de l’entreprise – à l’époque, intégrer ainsi une fille dans les affaires était une démarche on ne peut plus moderne.
Le fils de Carl Johann, Friedrich Carl, né l’année de la révolution, écrit 90 ans plus tard dans ses mémoires : « Les deux associés devant se séparer en raison de la liquidation de l’entreprise, mon père eut la possibilité de choisir l’un deux. Son choix se porta sur Monsieur Heintze. C’est ainsi que vit le jour à Weinheim la société Heintze & Freudenberg, qui reprit en 1849 la petite tannerie de peaux de veaux. »
Mais pourquoi achète-t-il des parts de l’usine de cuir avec Heintze, et non des parts du commerce de cuir de son oncle ? Du point de vue de l’entrepreneur, celle-ci présente des potentiels organisationnels et de croissance beaucoup plus importants qu’un « simple » commerce de maroquinerie. « C’est la clairvoyance entrepreneuriale de Carl Johann qui se dessine ici », commente Julia Schneider. Et puis : « Sa conviction de pouvoir réussir même dans ces temps tourmentés repose sans aucun doute sur le fait qu’il a déjà bravé une fois avec succès une crise financière dans sa jeunesse et que ses talents et ses vertus lui ont permis ensuite de réussir. C’est une situation qui se répète et qu’il a déjà maîtrisée dans le passé. Et cette fois, il est fermement résolu à tirer parti de son expérience et de ses points forts. » C’est ainsi que, en pleine révolution il jette les bases de ce qui deviendra une entreprise mondiale. Le 9 février 1849, un vendredi, les associés scellent officiellement, par une inscription au registre du commerce, la fondation de la société Heintze & Freudenberg. La révolution sera écrasée quelques mois plus tard.
Le chef d’entreprise
Au cours des trois années qui suivent, le chiffre d’affaires quadruple, le nombre d’employés passe de 50 à 170. « Trois aspects sont importants ici », souligne Julia Schneider. D’une part, la qualité : « Il existe dans la seule Allemagne à cette époque quelques 10.000 entreprises produisant du cuir. Freudenberg sait qu’Heintze et lui ne peuvent se distinguer que par la qualité. » D’autre part, il a aussi parfaitement conscience du fait qu’il lui faut internationaliser rapidement tant l’achat des peaux et que la vente des cuirs. Selon le slogan « Go big or go down », les deux partenaires établissent de nouvelles relations commerciales aux É.-U., en Suisse, en Grande-Bretagne, en France et en Turquie (qui était encore à l’époque l’Empire ottoman). Enfin, Freudenberg comprend très tôt l’importance des innovations, et, reprenant une mode venue de France, se met à fabriquer du cuir vernis. Il doit s’imposer ici contre son partenaire Heintze. « Ceux qui portent des chaussures vernies se déplacent en calèche, ceux qui portent du cuir normal vont à pied », déclare-t-il, et fait une nouvelle fois preuve de sa clairvoyance : à l’exposition universelle de 1851 à Londres, ce produit de Weinheim reçoit un prix et il assurera le succès de l’entreprise pendant de longues années.
Le bon père de famille
Après avoir racheté en 1874 la totalité des parts de la famille Heintze – une fois de plus grâce au soutien financier de la famille de son épouse –, Carl Johann peut montrer enfin son côté de patron soucieux de son personnel, ce à quoi son partenaire, uniquement préoccupé des aspects économiques, avait fait obstacle jusque-là. La même année, il fonde une association d’assurance maladie, qui deviendra plus tard la caisse maladie propre de Freudenberg, puis un fond de soutien pour les employés dans le besoin et leurs familles. « On voit bien ici le rapport avec ses souvenirs d’enfance », déclare Julia Schneider.
Freudenberg fait entrer dans l’entreprise, pour le soutenir, ses fils Friedrich Carl et Hermann Ernst, et en fait ainsi une entreprise familiale. En 1887, ils deviennent ses associés avec un tiers des parts chacun. L’entreprise compte alors déjà plus de 500 employés. Préparant le passage à la génération suivante et compte tenu de la taille qu’avait atteint la société Carl Johann rédige en 1887 ses Principes directeurs, de sa propre main. Modestie, honnêteté, assise financière et adaptation sont pour lui les principes fondamentaux de succès de toute activité commerciale. La confiance – non seulement en soi, mais également dans la famille, les partenaires, les collaborateurs – joue elle aussi un grand rôle. « Mieux vaut faire confiance cent fois, au risque de se tromper, que de se méfier une seule fois à tort. »
Marqué par les revers de fortune, Carl Johann Freudenberg s’est toujours, par son assiduité, son sens de l’économie, sa confiance en soi et sa fidélité à ses principes, « efforcé de tirer le meilleur parti de toutes les situations », pour le citer (Principes commerciaux). D’une grande clairvoyance entrepreneuriale, ouvert au changement et aux innovations, résolument confiant, il devient un entrepreneur dont le succès et l’héritage impose aujourd’hui encore leur empreinte à la culture de notre entreprise.
Ces principes formulés alors restent la base des principes commerciaux valables dans l’ensemble du Groupe Freudenberg.